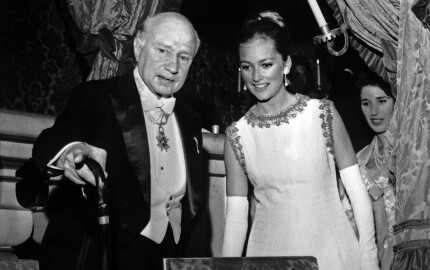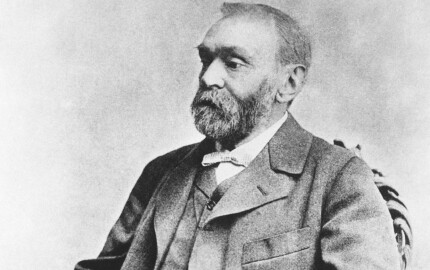Un nez saillant, aux narines bombées. Des lèvres fines et un menton en galoche. Malgré son allure frêle, un peu voûtée, la statue de madame Tussaud, exposée dans le musée londonien qui porte son nom, respire la ténacité ainsi qu’une forme de sagesse. La vieille dame ne dit rien des tourments qu’elle a connus avant de faire de ses poupées de cire une institution. Elle veille là, silencieuse, sur ce monde extraordinaire où cohabitent Michael Jackson, la famille royale britannique et David Beckham.
À en juger par ses mémoires, publiés en 1838, l’existence de madame Tussaud n’aurait été qu’une série d’heureuses rencontres. Le récit est une success story avant l’heure et son héroïne semble avoir traversé les affres de l’Histoire avec une placidité édifiante. Mais de l’avis des historiens, ces souvenirs qu’elle a livrés peu avant ses 80 ans sont pour beaucoup exagérés ou inventés de toutes pièces. Souvent, ils sont purement et simplement invérifiables. Une chose est certaine, madame Tussaud, qui gagne sa renommée au XVIIIe siècle en figeant ses modèles dans une matière alors considérée sans noblesse, n’a connu aucun répit avant de voir son nom s’inscrire en lettres d’or sur Baker Street, à Londres.
Prise sous l'aile d'un docteur
Née à Strasbourg, en 1761, Marie Grosholtz est élevée seule par sa mère, femme de ménage. Son père descend d’une lignée de bourreaux et meurt peu après la naissance de sa fille, au cours de la guerre de Sept Ans. Marie n’a pas 4 ans quand sa mère entre au service du docteur Philippe Curtius, à Berne. Cet homme peu conventionnel produit des cires anatomiques pour la faculté de médecine. Il prend sous son aile la petite Marie qui devient incollable sur le corps humain. Mais lassé par son travail au service des sciences, Philippe Curtius s’adonne à une autre marotte : la sculpture de bustes. Fini la reproduction d’organes. La cire, matière d’une divine souplesse, doit célébrer les vivants. Le médecin quitte ainsi la Suisse pour un nouvel Eldorado: Paris.
Dans son atelier de la rue du Petit-Moine, il initie Marie à la céroplastie. Mouler le visage de clients impatients. Sentir la moindre tension sous la peau du modèle ou encore sa mollesse. Dessiner les détails qui devront apparaître au maquillage : sourcils broussailleux, grains de beauté, taches de rousseur… le résultat est à chaque fois sidérant.
Bientôt, toute la capitale entend parler des œuvres du docteur Curtius. Un jour, une jeune femme au visage d’ange, dont les joues resplendissent tels deux pétales de rose, lui passe commande. La cliente n’est autre que la comtesse du Barry, favorite du roi Louis XV. Après elle, les intellectuels se ruent chez l’artiste. En 1776, les sculptures du médecin suisse sont exposées au PalaisRoyal. Les affaires s’emballent, et Marie peut désormais réaliser du début à la fin ses propres bustes.
De célèbres modèles
Son premier modèle a pour nom FrançoisMarie Arouet, dit Voltaire. L’année suivante, en 1778, elle immortalise JeanJacques Rousseau, puis Benjamin Franklin, de passage à Paris. En 1782, Curtius ouvre un nouveau cabinet, boulevard du Temple séparant le IIIe arrondissement de Paris du XIe , baptisé la Caverne des Grands Voleurs. Y sont exposées les plus grandes figures de la Ville lumière, mais aussi celles du petit peuple, ses phénomènes de foire, ses criminels, empoisonneurs ou bandits de grands chemins.
Lorsque la Révolution éclate, Curtius doit exposer ses modèles ou les ranger selon la grogne du moment. Il trouve ainsi plus prudent de fondre les statues de Louis XVI, de Marie-Antoinette et de leurs enfants, qu’il avait mises en scène au cours d’un repas dominical. La famille royale a longtemps représenté l’un de ses plus gros succès, mais désormais les effigies risquent de lui coûter la vie. D’autant que Marie, selon les révélations qu’elle fera dans ses mémoires – et qui sont aussi improuvables que les ascendances nobles qu’elle s’inventera –, aurait vécu à Versailles. Elle y aurait été employée pour enseigner le dessin à Madame Élisabeth, sœur du roi.
Le 12 juillet 1789, le peuple fait irruption chez Curtius et s'empare des bustes du ministre des Finances Necker, fraîchement remercié par Louis XVI, et du duc Orléans. Les deux trophées sont enveloppés d’un funèbre crêpe noir et défilent, portés par la foule jusqu’à la place Vendôme. Ils ne sont rendus au cabinet de cire que quelques jours plus tard, accompagnés de vraies têtes plantées au bout de piques. Et il revient à la jeune Marie de réaliser le masque mortuaire de ces soldats royaux, morts pendant la prise de la Bastille.
Un réalisme à frémir
Lorsque Louis XVI et Marie-Antoinette sont guillotinés, Marie Grosholtz est de nouveau désignée pour créer leur empreinte funéraire. Son talent ne lui aurait toutefois pas évité d’être emprisonnée à son tour, en 1794, en tant que sympathisante de la famille royale. Elle dira plus tard avoir partagé la cellule de Joséphine de Beauharnais à la prison des Carmes. Le peintre David, admiratif de son art, aurait toutefois intercédé en sa faveur, alors qu’elle était sur le point de monter sur l’échafaud. Ce qui est certain, c’est que la même année, quand Robespierre est à son tour décapité et Marat retrouvé assassiné dans son bain, Marie est appelée pour leurs ultimes effigies. Sa maîtrise de la cire est indiscutable. Le réalisme de ses bustes est à frémir. Et plus que jamais, elle peut affirmer sa technique. Philippe Curtius, son mentor, meurt en lui léguant toute sa collection de bustes.
Marie Grosholtz est désormais seule. François Tussaud, l’ingénieur qu’elle épouse en 1795, ne lui est d’aucun soutien. Alcoolique, il devient même un poids supplémentaire pour Marie, qui lui a donné deux fils, Joseph et François. Comme Curtius en son temps, à Paris, elle décide de tenter le tout pour le tout outre-Manche, après avoir rencontré Paul de Philipsthal. Passionné d’optique, plus charlatan que magicien, ce nouveau partenaire monte des spectacles itinérants faisant apparaître des divinités ou des fantômes. Quelques figures de cire et des moules dans ses bagages, Marie s’exile en Angleterre, où ses fils la rejoignent. Avec son associé, elle sillonne les routes jusqu’en Irlande et en Écosse, de foire en foire. Ses effigies peuplent les fantasmagories de Philipsthal et offrent aux foules des sensations fortes, mais madame Tussaud n’apprécie pas la façon dont elles sont employées. Elle décide de prendre son indépendance pour présenter comme il convient, et dans toute la Grande-Bretagne, ces personnages qu’elle a façonnés.
.jpg)
En 1835, lassée de cette vie sur les routes, Marie installe définitivement son entreprise artistique à Londres, sur Baker Street. Les Londoniens sont intrigués par ces "témoignages" de la Révolution française du musée Tussauds. Louis XVI et Marie-Antoinette, Napoléon et Joséphine sont ses personnages les plus attractifs. Les visiteurs affluent pour les admirer. En parfaite femme d’affaires, Marie Tussaud sait attirer les spectateurs en créant des catalogues d’exposition qui se lisent comme des livres d’histoire et détaillent, entre autres, la carrière militaire de Napoléon I er ou révèlent les lettres de Charlotte Corday écrites en prison.
La collection Tussaud continue de croître. L’aristocrate anglo-irlandais Arthur Wellesley, duc de Wellington, aime y admirer son double en cire. À l’occasion de son couronnement, en 1838, la reine Victoria se prête au jeu. Le musée devient une véritable institution. Octogénaire, Marie Tussaud sculpte encore. Elle réalise même son dernier autoportrait, qu’elle installe à l’entrée du musée… près de la caisse. Sa vie lui a permis de s’extirper de son milieu, de mettre à l’abri ses deux fils et ses petits-fils, déjà initiés...
Connectez-vous pour lire la suite
Profitez gratuitement d'un nombre limité d'articles premium et d'une sélection de newsletters
Continuer
Un journalisme d’excellence, des contenus exclusifs, telle est la mission de Point de Vue. Chaque article que nous produisons est le fruit d’un travail méticuleux, d’une passion pour l’investigation et d’une volonté de vous apporter des perspectives uniques sur le monde et ses personnalités influentes. Source d’inspiration, notre magazine vous permet de rêver, de vous évader, de vous cultiver grâce à une équipe d’experts et de passionnés, soucieux de porter haut les couleurs de ce magazine qui a fêté ses 80 ans. Votre abonnement, votre confiance, nous permet de continuer cette quête d’excellence, d’envoyer nos journalistes sur le terrain, à la recherche des reportages et des exclusivités qui font la différence tout en garantissant l’indépendance et la qualité de nos écrits. En choisissant de nous rejoindre, vous entrez dans le cercle des amis de Point de Vue et nous vous en remercions. Plus que jamais nous avons à cœur de vous informer avec élégance et rigueur.